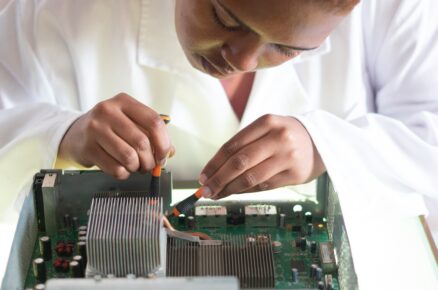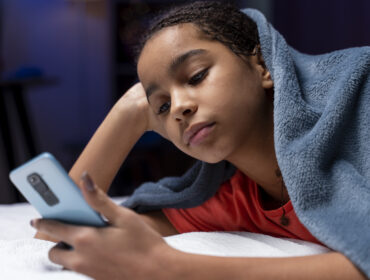En Afrique, les données de santé passent progressivement du papier au numérique. Une transformation cruciale pour améliorer la qualité des soins et mieux répondre aux besoins des populations.
Si des pays comme le Sénégal montrent la voie, le défi reste de taille : infrastructures limitées, gouvernance floue, manque de normes. Soutenus par l’OMS, les États tentent de relever le pari d’une santé connectée et plus efficace.
La digitalisation des données de santé (DDS) est devenue un pilier essentiel des systèmes de santé mondiaux, et l’Afrique ne fait pas exception. D’ailleurs, plusieurs pays de la région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé(OMS) en ont fait une priorité d’action à côté de beaucoup d’autres priorités de développement durable.
«La digitalisation des données de santé en Afrique aujourd’hui est un enjeu stratégique pour améliorer la qualité des soins. Autrement dit, cela va permettre aux populations de bénéficier des soins de qualité.
C’est aussi un enjeu de sécurité», affirme le Dr Serge Bataliack, spécialiste de l’information stratégique en santé dans la région Afrique de l’OMS. Pour sa part, Dr Samba Cor Sarr insiste plutôt en disant que «le processus de digitalisation des données de santé est irréversible…si nous voulons accélérer notre développement».
Et c’est pour cette raison que le directeur de la santé publique de l’Institut Pasteur de Dakar, Dr Abdourahmane Sow pense que la digitalisation aujourd’hui constitue une opportunité pour tout le système de santé, pour l’amélioration des offres de soins. «C’est aussi un outil important de planification sanitaire», a- t-il insisté.
Plusieurs pays africains se sont inscrits dans la dynamique de digitalisation des données de santé car elle est considérée comme une stratégie instrumentale pour le renforcement des systèmes de santé et s’inscrit donc dans le cadre de la mission de réingénierie des systèmes de santé.
Des pas importants dans des pays africains
Au Sénégal, depuis 2017, un chemin a été fait pour positionner le pays sur ces indicateurs de performance du système de santé. L’innovation récente selon les autorités ministérielles, est l’acquisition d’un logiciel moderne pour les dossiers médicaux des patients. «Le pays vient d’avoir quand même un logiciel, un système d’information pour le dossier médical des patients.
Je pense que ça, c’est la forte innovation, c’est une forte avancée.» nous apprend le Dr Ibrahima Dia, le coordinateur de la cellule santé & numérique du ministère sénégalais de la santé et de l’action sociale. Il rapporte qu’ « aujourd’hui, nous avons 12.000 patients qui vont bientôt avoir accès aux données avec une carte de santé. Ça aussi, c’est un point fort.»
En dehors de ces avancées, le Dr Ibrahima Dia martèle que des efforts ont été fait sur d’autres régistres. «On a une cellule de santé digitale, on a une cellule informatique, on a une division du système d’information». Sur le plan des infrastructures, poursuit la même source, «nous avons des data center, nous avons 4500 km de fibres optiques.
Si on prend les applications, on a quand même des applications qui existent comme DHIS2 (District Health Information Software version 2) ou IHRIS pour les ressources humaines», énumère – t-il.
A en croire le professeur Cheikh Oumar Bakayoko, le Mali n’est pas resté en rade vis-à-vis de ses innovations technologiques. Interrogé à Dakar, ce chercheur en informatique de santé, d’origine malienne, affirme que «le Mali à l’instar de beaucoup de pays en Afrique subsaharienne a entamé la digitalisation des données de santé il y a plusieurs années. Cela va, dit-il, du niveau communautaire jusqu’au niveau central. Il y a beaucoup d’applications qui sont utilisées. » clarifie t-il.
Le Rwanda a engagé des efforts pour la digitalisation de ses données de santé. Un projet de digitalisation du système de santé du pays existe et s’aligne d’ailleurs, sur le plan stratégique One Health II (2019-2024).
Pour rappel, un aspect clé de cette stratégie est l’amélioration de l’interopérabilité des systèmes, ainsi que le renforcement des infrastructures de santé numérique.
A titre d’exemple, le pays s’est doté d’un drone de livraison médicale dénommé Zipline. Et, le TracNet, un outil qui implique l’utilisation de téléphones mobiles rechargeables à énergie solaire pour lutter contre les pandémies.
Avec plus de 13 ans d’années d’expériences dans la conception et le renforcement des solutions de santé numériques pour l’amélioration des soins de santé au Rwanda, Jean Marie Vianney Ntibazamushobora est spécialiste en informatique de santé à l’Université du Rwanda.
Approché par notre reporter lors d’un séjour à Dakar, il confie que le Rwanda s’est lancé dans ce processus depuis des années. « De 2005 à 2006, presque 80 % des institutions utilisent des logiciels de santé pour gérer leurs dossiers.», a-t-il déclaré à notre reporter.
Pour cet interlocuteur, les premiers investissements du pays ont pris en compte les questions d’infrastructures et de connectivité. En d’autres termes, selon lui, les moyens ont été mis pour assurer une bonne couverture d’internet sur le territoire.
«Après la gestion des dossiers, on a essayé d’implémenter, dit-il, d’autres systèmes comme le système qui utilise des drones pour la distribution des poches de sang et de vaccins dans les villes et surtout les milieux ruraux», ajoute-t-il.
“…Les fondamentaux manquent… “
En Afrique Subsaharienne, des investissements non négligeables sont faits pour un réel décollage de la DDS. Selon le professeur Cheikh Oumar Bakayoko «le Mali vient de développer une vision pour faire face à la fragmentation (ndlr: du secteur), et pour essayer de partir de cette vision et mettre en place les fondamentaux».
Pour ce chercheur, d’une manière générale, il y a beaucoup de services qui sont développés dans nos pays mais les efforts sont parfois heurtés à des défis. «Il y a des services qui sont développés mais, dit-il, les fondamentaux manquent pour que ces services-là puissent être exploités dans toutes leurs potentialités pour mieux soigner le patient et piloter la santé publique», explique le chercheur.
Pour renforcer ses propos, l’expert de l’OMS pour l’Afrique, Dr Serge Bataliack, relève que le continent est confronté à un défis de gouvernance en la matière. «Le premier défi qui est la base est un défi de gouvernance.
Lorsqu’on parle de gouvernance , on parle de vision , on parle de prospective… c’est-à-dire comment est-ce qu’on entrevoit la digitalisation des systèmes de santé en Afrique » fait-il savoir.
Au Sénégal, une volonté politique est affichée par les gouvernants avec le lancement de la “New Deal Technologique” qui vise à renforcer la souveraineté numérique du pays et à répondre aux besoins dans divers secteurs, y compris la santé rappelle le Dr Ibrahima Dia, coordinateur de la Cellule santé & numérique du ministère de la santé et de l’action sociale.
Selon le Directeur du cabinet du ministre de tutelle, Dr Samba Cor Sarr, la “New Deal Technologique” du Sénégal «est une grande offensive pour réussir en un temps record une digitalisation intégrale du système de développement économique et social de notre pays».
Les normes et standards
Pour le spécialiste Dr Serge Bataliack, il y a aussi le défi de la «standardisation». Il est important dit-il de créer des standards nationaux qui vont faciliter ses échanges et la communication.
Pour étayer ses affirmations, le professeur Cheikh Oumar Bakayoko affirme quant à lui qu’il faudrait mettre en place «le cadre d’interopérabilité qui sont les règles et les contraintes d’échanges entre les différents outils utilisés pour mieux prendre en charge le patient».
Selon lui, quand un patient va quitter un point A pour un point B ou C, il faut que ses données se suivent et on sait que le point A peut utiliser un outil différent du point C ou du point B. Il faut donc, suggère-t-il, «que tous ces points-là, puissent utiliser le même langage, le même standard de partage des données».
Ce chercheur, spécialisé en informatique de santé, évoque aussi la mise en place d’un identifiant unique du patient qui pour lui est un élément qui va accompagner le cadre d’interopérabilité.
« Si on ne sait pas identifier le patient d’un hôpital à un autre, d’une région à une autre, c’est qu’on peut commettre des erreurs sur sa prise en charge. Et même on ne serait pas capable d’alimenter comme il le faut le système de santé public du pays». prévient-il.
En matière d’infrastructures de qualité, ce cadre de l’OMS trouve qu’«il faut qu’on ait une infrastructure de connectivité pas seulement dans les centres urbains mais surtout en milieu rural ».
Parce que, explique – t-il, «les données de santé existantes montrent que les populations, en fonction du milieu de résidence, du genre, de la région, de l’âge, ne bénéficient pas des mêmes chances d’avoir des soins de qualité. Donc la connectivité peut aider à résoudre ces problèmes ».
L’OMS au coeur de la DDS en Afrique
L’un des rôles de l’OMS dans ce processus de digitalisation des données de santé est d’aider les pays à mettre en place des normes et des standards selon le Dr Serge Bataliack, spécialiste de l’information stratégique en santé dans la région Afrique de l’OMS.
«Il y a un standard et une norme sur la classification internationale des maladies…Si on sait de quoi les gens sont malades, si on sait de quoi les gens sont morts, on est capable de développer des politiques plus ciblées qui impactent la société, avoir des chiffres au détail près», dit-il.
L’expert explique que la standardisation implique par exemple la définition des appellations identiques pour identifier les mêmes pathologies. «Vous allez dans un hôpital, on vous dit que vous souffrez du palu, ailleurs quelqu’un d’autre va écrire paludisme , l’autre va écrire malaria.
Pourtant on parle de la même réalité; mais avec la clarification internationale des maladies, on dira que c’est le paludisme mais c’est codé P001, dans l’autre hôpital c’est codé aussi P001. A la fin, on sait que chaque patient souffre vraiment du paludisme».
Au-delà, le leadership et la gouvernance doivent être de mise au sein des Etats pour véritablement amorcer les réformes numériques dans les systèmes de santé en Afrique Subsaharienne.
«Quand on développe une stratégie on dit se tenir à cette stratégie et tout doit se baser sur cette stratégie pendant l’année qu’elle couvre…il faut une gouvernance rigoureuse qui va permettre de développer cette digitalisation de façon harmonieuse et cohérente», conseille le professeur Cheick Oumar Bakayoko.
Le partage de bonne pratique et de facilitation est aussi l’un des rôles de l’OMS. «Étant une organisation globale, on a accès au quotidien à des échanges avec des acteurs internationaux dans les pays et gouvernements où des bonnes pratiques peuvent aider d’autres pays à gagner du temps» confesse selon notre interlocuteur.
Pourquoi réinventer la roue pour refaire les mêmes erreurs qu’un pays X a fait alors que je peux me servir de cette expérience pour avancer de 10 ans, 15 ans ? D’autant plus que les évidences existent, les preuves existent? S’interroge ce cadre de l’OMS.
Toutefois, il faudrait une masse critique de spécialistes du domaine « il faut une masse critique d’experts dans ce domaine-là, d’experts locaux parce que le développement doit d’abord être un développement endogène, les solutions doivent être endogènes et tenir compte des questions anthropologiques et sociales de chaque pays» conclut Dr Serge Bataliack.
Kuessi Giraud Togbé